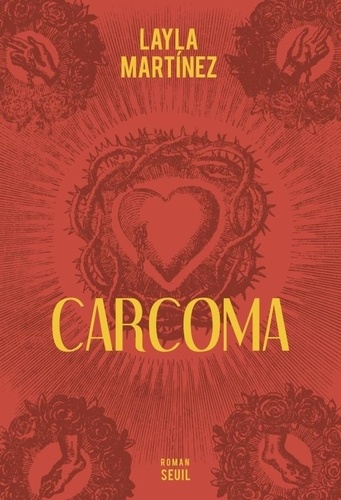
« C’est ça, la famille, un endroit où on te fournit le gîte et le couvert, en échange de quoi tu es piégée avec une petite troupe de vivants et une autre de morts. Toutes les familles ont leurs morts sous les lits, la seule différence c’est que nous, on voit les nôtres, disait ma mère. »
La vrillette est un insecte nuisible de type xylophage, nous apprend le dictionnaire. La vrillette ronge le bois, elle creuse, s’engouffre dedans, le rend poreux. La vrillette, en espagnol, se dit Carcoma. Et lorsque l’on met le pied dans la maison des deux femmes de cette famille, la grand-mère et la petite fille, on comprend que les murs sont poreux et laissent passer les morts et les incursions lancinantes d’une histoire dirigée toujours contre les femmes. Les premières lignes nous donnent le ton, la maison est un personnage autant que les autres, et elle ne nous laissera pas de répit.
« Quand j’ai franchi le seuil, la maison s’est jetée sur moi. C’est toujours pareil avec ce tas de briques et de crasse. Il se rue sur tous ceux qui passent la porte et leur tord les boyaux jusqu’à leur couper la respiration. Ma mère disait que cette maison faisait tomber les dents et asséchait les entrailles, mais il y a longtemps qu’elle a pris le large et je n’ai plus aucun souvenir d’elle. Elle disait ça, je le sais, c’est ma grand-mère qui me l’a raconté, pourtant elle aurait pu s’épargner cette peine parce que j’étais déjà au courant. Ici tes dents, tes cheveux et ta chair tombent et à la moindre inattention tu te retrouves à te traîner d’un coin à l’autre, ou tu te mets au lit pour ne jamais te relever. »
À deux voix, l’aïeule et la plus jeune femme du foyer vont nous livrer l’histoire familiale. On comprend vite que la petite fille revient d’un temps en prison, on saura vite pourquoi, et à quel point ce qui lui est arrivé n’est que l’issue inévitable d’une histoire familiale hostile aux femmes et aux pauvres. La mère, chaînon manquant entre les deux femmes, a disparu à la fin de l’adolescence, revenant parfois hanter la maison, éternellement jeune et hagarde, comme incapable de rentrer véritablement chez elle. Les deux habitantes évoluent côte à côte dans un mélange de haine et de protection farouche, liées malgré elles et à jamais par le sang et la haine des hommes, qui, comme on le sait « mentent et exagèrent pour satisfaire leurs désirs, qu’il ne faut pas croire un tiers de ce qu’ils racontent et que le reste c’est du flan ».
L’ambiance, insidieuse et rampante, de malédiction et de colère teinte le roman d’une tonalité à la fois effrayante et fascinante. Layla Martinez brille par son efficacité dans la narration, et sa manière de formuler les réflexions de ses personnages. On assène des vérités de manière étonnamment sage et agressive, on convoque la rage avec une banalité désarmante. Je ne suis pas étonnée que ce roman ait reçu des éloges de Mariana Enriquez, tant l’atmosphère se rapproche de l’oeuvre de l’autrice argentine. Et, ça a son importance, la traductrice est celle des romans de Natalia Garcia Freire, autrice équatorienne aux ambiances horrifiques et grouillantes. La filiation littéraire est là, on baigne dans une horreur suintante des murs qui dépasse le cadre du réalisme magique. Le voile séparant les morts des vivants est en lambeaux, et les deux mondes, poreux, s’entremêlent. Ce champ lexical est au service d’un propos politique sur la condition des femmes et la violence qu’elles subissent, mais aussi engagé vers une lutte des classes où le mépris doit se retourner vers les puissants.
« Les hommes affluèrent, plus d’un parcourut le chemin depuis le village pour venir lui parler devant la grille, mais elle les chassait à grands cris, leur demandant s’ils n’avaient pas honte de tourner autour d’une veuve qui portait encore le deuil. Aucun ne franchit le seuil de la maison. Elle n’avait eu qu’un seul homme et c’était bien assez. Quand on est seule et pauvre, on ne peut pas se permettre de refaire deux fois la même erreur, ça aussi, nous le savons parfaitement dans cette maison. »
Et si Carcoma ne peut pas prétendre à être comparé aux oeuvres de Mariana Enriquez en terme de densité, je crois qu’il faut prendre cette addition aux romans horrifiques féministes comme un ajout bienvenu car, pierre après pierre, se dessine un fascinant corpus. L’univers déployé par les autrices hispanophones mêlant luttes sociales et fantastique/horreur est d’une immense richesse, et j’ai hâte de le voir s’étoffer au fil des années, notamment avec la normalisation de romans aux personnages d’unhinged women. J’ai souligné tant de phrases de ce roman, pour leur efficacité, et j’aurais pu, malgré l’hostilité et la respiration dérangeante de cette maison, y passer quelques centaines de pages de plus, happée par l’ambiance. Mais c’est à nos risques et périls, car qui sait si, à l’usure, la carcoma ne finirait pas par ronger notre cerveau ou notre âme.
Carcoma. Layla Martinez. Traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon. Editions du Seuil (maison appartenant au groupe Média Participations), 2025. 155p.

